Oubliés de la grande « Histoire de l’art », les portraits anonymes sont légion dans les réserves des musées. Anonymats du modèle et anonymats de l’artiste emplissent le silence des rayonnages. Pourtant chaque œuvre est une énigme surgie du passé, et de ce que fut un jour expérience forte de mise à nu dans le silence feutré d’un atelier ne subsiste que trace d’une main, sur la toile ou le papier. Et souvent aussi le temps y va de son empreinte par déchirure, dégradation du support, effacement…
La première confrontation avec un portrait anonyme est pour moi toujours un choc puisque c’est la rencontre avec une absence. Chacun, je pense, a fait l’expérience de l’indifférence ou du mystérieux attrait que peut faire naître en nous la révélation d’un visage inconnu. Ce sont alors moments d’égarement, de questionnement avant que l’œil ne saisisse, dans ce visage étranger, un point d’ancrage d’un dessin à naître sur ma feuille blanche.Oublieux de cet évènement fortuit qui figeait pour la postérité telle dame de compagnie de la cour ducale de Lorraine, tel magistrat du second Empire, mon plaisir au dessin est dans la captation de ce regard perdu et dans l’ouverture à un espace mental qui va donner corps à un nouveau visage.

Huiles sur toile, Musée du château de Lunéville (formats divers)

Encre et collage sur papiers Japon, 100 x 100 cm (2010).
Qu’est-ce donc que cette nouvelle figure ? Elle se déploie dans la trace fugace d’une mémoire. Elle flotte dans un espace et un temps incertain. Elle m’impose aussi dans sa fragilité la légèreté d’une technologie réduite au pinceau et à l’encre sur un papier japon très léger, dont le froissement participe de l’incertitude de la forme. La translucidité du papier m’autorise une superposition de plusieurs feuilles peintes, comme autant de strates à franchir avant d’accéder à la vérité d’un nouveau visage. Si le portrait est un passionnant objet d’étude, c’est qu’il tente depuis toujours de percer le mystère de ce visage, miroir des sentiments. Questionnement nourri au XVIIIe siècle auquel Jean-Jacques Rousseau répondait par cette formule :
Hommes savants dans l’art de feindre
Qui me prêtez des traits si doux,
Vous aurez beau vouloir me peindre,
Vous ne peindrez jamais que vous.
J’ai été confronté à ce questionnement des œuvres anonymes lorsque je préparais l’exposition « Regards croisés » au château de Lunéville en 2010. J’y ai travaillé à partir d’une sélection très subjective de peintures et gravures « anonymes » conservées dans les collections muséales du château, riche d’œuvres du siècle des Lumières et du XIXe siècle. Acte pur de dessin, ai-je dit, que je souhaitais renforcer par le fait même que ma source d’inspiration était garante de l’anonymat de la main ou du modèle d’origine. Dans l’impossibilité d’inscrire un portrait, quel qu’il soit, sur le néant d’une feuille blanche, il me fallait un point d’ancrage : le regard, centre de gravité de l’intime. Mais de quelle intimité s’agit-il, qui en réfère à un(e) inconnu(e)? Comme un défi d’inscrire un nouveau visage dans le périmètre du papier, c’est donner sens à une géographie singulière de surfaces saillantes, de traits, de rides, de plis d’habits. C’est s’en approprier le territoire ouvert et, en tâtonnant, l’habiter de sa propre subjectivité…




Encre et collage sur papiers Japon, 100 x 100 cm (2010). Cliquer sur l’image.








Encre et collage sur papiers Japon, 40 x 50 cm (2010).












craies d’art sur papier, 24 x 33 cm (2010).
L’exposition « Regards croisés, figures anonymes » eut lieu en juillet/août 2010
Dessins (encre et monotypes sur papiers marouflés) inspirés des collections du musée.
Musée du château de Lunéville, Meurthe-et-Moselle.






































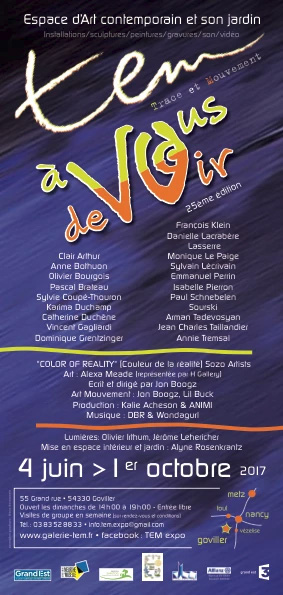









 Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy
Jacques KOSKOWITZ, « Les Rouge-verts », dessins sur papier, 50×70 cm, années 80. ©jm Dandoy